 Le système
de verrouillage des balistes
Le système
de verrouillage des balistes
par Frank Schneidewind & Ingo Schindler - Datz 5/2000
Leur nom vernaculaire dérive d'une construction particulière
de la nageoire dorsale. Elle est inhabituelle, si bien que nous allons
la détailler ici.
La famille des Balistidae fait partie de l'ordre des Tetraodontiformes
et comprend douze genres avec 40 espèces, qui en fonction de l'opinion
actuelle forme une famille propre proche parente de celle des Monacanthidae.
Du point de vue taxonomique les balistes sont connus depuis longtemps
et correctement étudiée. Avec leurs proches parents les
poissons coffres ils font partie d'un groupe des plus spécialisés
des poissons osseux (Tyler 1980).
Ces poissons sont étonnants du point de vue de la construction
corporelle, de la forme, de la taille et du mode de vie. Les caractères
de reconnaissance des Tétraodontiformes sont une petite bouche
non protractile avec soit peu de dents souvent agrandies (Balistoidei)
soit avec des plaques dentaires massives et en forme de bec (Tetraodontoidei).
En outre, ils ne possèdent que de petites ouvertures branchiales
en forme de trous et un nombre restreint de vertèbres. Le corps
est protégé par des écailles agrandies en forme de
carapace. Le volume crânien est relativement important comparé
à celui de la masse corporelle.
Des chercheurs en comportement attribuent aux balistes des capacités
extraordinaires d'intelligence basées sur leur mode de vie en rapport
avec leur acquisition de nourriture dans le récif corallien tridimensionnel
et dans l'espace fortement structuré ainsi qu'à l'aide de
leur orientation binoculaire.
 La plupart
des Balistidae sont des poissons coralliens typiques qui sont présents
dans le monde entier aussi bien dans les régions tropicales que
subtropicales. Ils sont représentés par une espèce
en Méditerranée (Balistes cardinensis).
La plupart
des Balistidae sont des poissons coralliens typiques qui sont présents
dans le monde entier aussi bien dans les régions tropicales que
subtropicales. Ils sont représentés par une espèce
en Méditerranée (Balistes cardinensis).
Les balistes se font remarquer par leur patron corporel "abstrait"
(comme Rhinecanthus aculeatus) et en forme de plaques (comme Balistoides
conspicillum). Chez de nombreuses espèces il se produit au
cours de l'ontogénèse (développement individuel)
un net changement de coloration (comme chez Pseudobalistes fuscus).
Impressionnante est la taille finale du baliste géant (Balistoides
viridescens), qui peut atteindre une longueur d'environ 75 centimètres.
Grâce à l'ondulation (mouvements ondulatoires) de certaines
nageoires il est possible aux Balistidés de nager en avant ou en
arrière par des mouvements précis dans le récif corallien
ramifié.
Les balistes se nourrissent à l'aide de leur mâchoire puissante
le plus souvent d'invertébrés à carapace dure. Ils
vivent soit en solitaire, en petits harems ou en bancs dotés d'une
organisation sociale. Certaines espèces sont très agressives
entre elles et territoriales. De nombreux balistidés pratiquent
les soins parentaux. La ponte est surveillée dans un nid préparé
à l'avance. Les minuscules larves éclosent en très
peu de temps (une à deux journées) et passent immédiatement
au mode de vie pélagique.
Les balistes sont connus des amateurs comme des poissons d'aquarium robustes
et agressifs mais avant tout intéressants qui avec de bons soins
peuvent devenir très âgés et confiants. Etant donné
que presque tous les balistes ne peuvent être associés avec
les organismes maintenus en aquarium récifal, ils sont devenus
plus rares dans l'aquariophilie marine. En sont exclus les espèces
planctonophages des genres Melichthys, Odonus et Xanthichthys,
qui n'importunent pas les animaux coralliens.
Le nom vernaculaire correspondant de "Drückerfisch" = poisson
gâchette ou arbalétrier, est en rapport avec une particularité
anatomique remarquable: toutes les espèces de cette famille possèdent
deux nageoires dorsales. La deuxième ressemble beaucoup à
la nageoire anale ; la première dorsale se compose toutefois que
de trois rayons osseux reliés entre eux par une peau. Le premier
rayon dur peut être dressé et fixé. Le "loquet"
qui déclenche le verrou, est constitué par le troisième
rayon dur. Ce mécanisme, qui va être décrit en détail
par la suite., rappelle la gâchette d'un fusil.
Cette ingénieuse particularité permet à ces animaux,
en liaison avec le rudiment de nageoire ventrale qu'il peut écarter,
de se caler dans des fentes rocheuses, de façon à ce qu'il
ne soit plus possible de les en retirer. Ainsi ces poissons d'activité
diurne sont-ils protégés la nuit ou en cas de danger face
à des prédateurs et ils bravent aussi de puissants courants.
Historique
Otto Thilo de Riga (Lettonie) a été l'un des premiers à
avoir essayé de comprendre en détail le système de
blocage des balistes. Entre 1889 et 1910 il a publié divers travaux,
qui ont été consacrés aux mécanismes de divers
systèmes de blocage du monde animal. Hélas, nombre de ses
conclusions et descriptions, malgré de nombreuses préparations,
se sont révélées fausses (Mohr, 1928).
Parmi les systèmes de blocage qu'il a représenté
se trouve aussi celui du premier rayon de la nageoire dorsale des balistes.
Thilo (1899) croyait avoir reconnu la droite d'une développante
( = courbe, qui est décrite à partir d'un point d'une droite,
qui se déroule sur un cercle), qui est poussé vers le haut
par rotation d'un os ayant la forme d'un demi-cercle. Cet os semi-circulaire
n'existe pas. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle le "loquet"
pouvait se fixer selon n'importe quel angle n'était pas soutenable.
Thilo (1899) a reconnu que chez certains modèles, qu'il a confectionnés
pour l'observation du mécanisme, il n'y avait pas besoin d'un profil
de développante afin d'obtenir l'effet désiré. L'amplitude
de l'erreur de Thilo a été mise en évidence par Mohr
(1928) par une excellente description de la mécanique du premier
rayon de la nageoire dorsale de Balistapus undulatus.
Avec l'exemple de Balistes vetula non seulement le mécanisme
représentatif des autres balistes a été mieux expliqué
mais aussi les os y participant ont été mieux décrits
(selon Matsuura 1979).
L'exemple Balistes vetufa
 |
Balistes vetula Linné, 1758 constitue l'espèce type du genre, qui comporte quatre espèces. Le nom Balistes provient de balanoo (verrouiller) et histos (mât) et se rapporte au premier rayon de la nageoire dorsale qui peut être dressé et verrouillé. B. vetula est connu sous le nom populaire de "Baliste reine". Cette espèce est largement répandue dans l'Atlantique des Caraïbes au Brésil et à l'Afrique du Sud. Les récifs coralliens, les zostères et les zones sablonneuses lui servent de biotope par une profondeur comprise entre 2 et 50 mètres. Cette espèce atteint une longueur de pouvant atteindre 60 cm et possède un patron attrayant. La couleur du corps est jaune brun. Deux lignes parallèles d'un bleu lumineux passant au-dessus de la bouche sont caractéristiques. La nageoire caudale est très allongée. Balistes vetula consomme des oursins avec prédilection.
Le mécanisme
La première nageoire dorsale se situe directement derrière
le crâne et se compose de trois éléments différents
: les trois rayons, deux porteurs des rayons de nageoires basales et d'une
apophyse supraneurale, qui n'a toutefois rien à voir avec le mécanisme
de verrouillage.
Le premier rayon de la nageoire dorsale est particulièrement long
et robuste. Il se situe dans une position en forme d'anneau dans la partie
antérieure du premier support de nageoire. Le côté
interne du rayon est presque emprisonné sur toute sa longueur.
Ce sillon se rétrécit seulement à la partie basale
du rayon par une surface osseuse rugueuse.
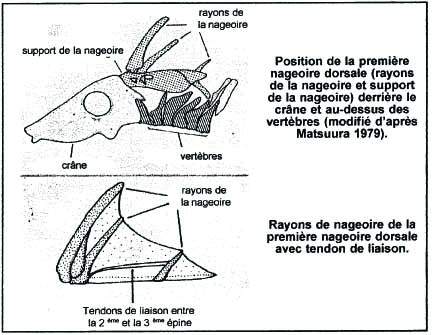 |
Le deuxième rayon est légèrement plus petit (chez
B . vetula environ 70% de la première) et se situe sur une
arête médiale impaire du support de nageoire. Le côté
interne est seulement légèrement sillonné ; la partie
extérieure comporte à la base du rayon un grossissement
spectaculaire, convexe et en forme de coin. La partie basale de ce rayon
comporte deux pointes, si bien qu'il reçoit un soutien latéral
sur l'arête qui possède une cambrure dorsale et peut glisser
d'avant en arrière et vice versa.
Si donc le premier rayon est dressé, le deuxième l'est de
manière simultanée, glisse par-dessus la cambrure de l'arête
porteuse de la nageoire et se trouve fixé dans une cavité.
Le bombement du deuxième rayon s'adapte exactement à l'encoche
du premier, si bien qu'ils peuvent se coincer réciproquement. Etant
donné que le deuxième rayon ne peut pas sortir de la fixation
du premier à cause de la pression, il n'est pas possible contrairement
à d'autres avis (Matsuura 1979) de libérer le verrouillage
des deux rayons par abaissement du deuxième, mais par soulèvement
simultané par-dessus la cambrure de l'arête mediumnique porteuse
de la nageoire. Ceci est possible par une liaison tendineuse entre le
deuxième et le troisième rayon dorsal.
Ce troisième rayon est beaucoup plus petit (environ 40% de la longueur
du plus grand rayon), librement mobile et se situe à distance plus
importante sur le deuxième support de nageoire. Le tendon jointif
se situe au bord intérieur du deuxième rayon directement
au-dessus de son point de rotation et mène environ au milieu du
troisième. Si le troisième rayon est mis de côté,
la peau de la nageoire située à l'extrémité
et le tendon du verrouillage du deuxième rayon se rétractent
(Mohr 1928) et libère le premier de son ancrage.
 |
| Première nageoire dorsale (support de nageoire et rayon) de Balistes vetula |
La transformation structurelle du rayon porteur de nageoire est particulièrement
remarquable, scientifiquement appelée pterygiophores. En comparaison
avec la plupart des autres poissons osseux les éléments
servant au maintien et à la stabilisation des nageoires ont subi
une modification impressionnante. En général ils ressemblent
à des rayons de nageoires prolongés dans le corps, sont
toutefois le plus souvent légèrement courbés, peu
élargis ou ronds et en forme d'aiguilles. Chez les balistes par
contre, les deux premiers supports de nageoires sont soudés (chez
B. vetula aussi longs que le premier rayon) et forment par leur forme
spécifique non seulement le support pour le mécanisme décrit
avant mais surtout un profond sillon dans lequel se trouvent les rayons.
Les balistes font partie des familles de poissons les plus développées,
dont l'observation soit dans la mer soit dans l'aquarium procure beaucoup
de joie.
Littérature
Matsuura, K. (1979) : Phylogeny of the superfamily Balistoidea (Pisces:
Tetraodontiformes). Mem. Fac. Fish. Hokkaido Univ 26 (1/2): 49-169.
Mohr, E. (1928): Zur Mechanik der vorderen Rückenstacheln bei Balistes
und Zeus. Zoologischer Anzeiger 75 (3-4): 49-53.
Schneidewind, F. (1994): Fische mit Personlichkeit: Drückerfische.
D.Aqua. u. Terr. Z. (DATZ) 47 (4) : 20-232.
- (in Vorbereitung) : Die Drückerfische. Balistidae. Dissendorf-Wulfen.
Tyler, J.C. (1980): Osteology, phylogeny and higher classification of
the fishes of the order Plectognathi (Tetraodontiformes). NOAA Technical
Report NMES Circular 434: 1-122.
© Extrait de la Gazette Marine N° 77 - octobre 2003
Publication réservée aux membres des Amis de l'Aquarium
1932
