 Phosphate
- une substance nutritive et sa limitation
Phosphate
- une substance nutritive et sa limitation
par Hans-Werner Balling (Datz 5/2002)
Le phosphate constitue en tant qu'élément constitutif du
patrimoine et de la "valeur énergétique" ATP une
substance nutritive indispensable pour tous les êtres vivants. Il
doit être disponible dans une certaine quantité minimale,
s'il ne doit pas devenir le facteur de croissance limitant.
Dans le récif de corail il règne une carence en phosphates,
qui limite la croissance des coraux et des algues. Par la symbiose entre
zooxanthelles et coraux durs cette substance nutritive est toutefois concentrée
dans le récif corallien.
Les algues, dont la croissance est limitée par une substance nutritive,
ne sont pas en mesure d'utiliser les combinaisons carbonées organiques
créées avec l'aide de l'énergie solaire. Si les phosphates
font défaut pour une croissance optimale, les hydrates de carbone
(= glucides), graisses et acides aminés élaborés
au moyen de la photosynthèse sont de nouveau éliminés
(Kohl & Nicklisch 1988). Un arrêt de la photosynthèse
n'est pas possible, puisque l'énergie solaire absorbée doit
être dérivée dans l'élaboration de combinaisons
riches en énergie, car sinon elle détruirait à coup
sûr l'appareil de photosynthèse.
Ainsi ces porteurs d'énergie passent de la zooxanthelle au corail.
Mais le scléractiniaire ne peut également utiliser cette
substance qu'en quantité mesurée pour la croissance, car
lui aussi souffre de la carence en phosphates. II n'a d'autre solution
que de sécréter ces substances organiques vraiment précieuses
avec le mucus.
Des êtres vivants entrent en jeu à ce moment, qui peuvent
valoriser ces sécrétions. De minuscules bactéries
ont la possibilité par leur superficie relativement grande et leur
système récepteur très efficace de concentrer les
phosphates dans leurs cellules, lorsque les systèmes récepteurs
des algues défaillent (Sorokin 1995 ; Sommer 1994). Ils ont ainsi
la capacité de transformer en croissance les porteurs d'énergie
organique, que les algues et les coraux ne peuvent plus utiliser. De cette
population croissante de bactéries une partie atterrit dans leurs
estomacs en compagnie du mucus, que les coraux transportent sur leur surface.
Les unicellulaires également, copépodes et autres filtreurs
utilisent la population de bactéries pour leur alimentation.
A diverses étapes les coraux écument les êtres vivants
concentrés en phosphates: avec leurs tentacules ils capturent les
crustacés, les vers ou des alevins et utilisent aussi leurs sécrétions,
réparties dans l'eau, contenant des phosphates. Ainsi les coraux
retrouvent une partie de l'énergie émise avant, maintenant
concentrée avec la substance nutritive la plus importante, les
phosphates. Les zooxanthelles profitent finalement aussi de la concentration
en phosphates par l' endosymbiose.
Le graphique montre la circulation des phosphates (symbole hexagonal "P") dans le récif corallien ; autres abréviations: C = carbone ; N = azote ; C/N = proportion carbone-azote ; DOM = substances organiques dissoutes
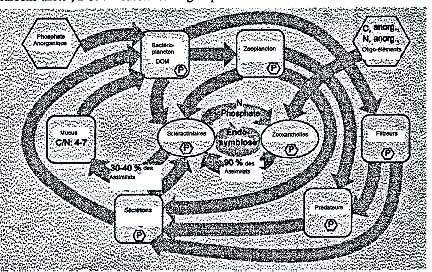 |
Contribution à la croissance du Quelette des scléractiniaires
Jusqu'à présent la calcification des coraux a été
expliquée avant toute chose par l'absorption de gaz carbonique
par les zooxanthelles durant la photosynthèse. Les scléractiniaires
symbiotiques croissent toutefois aussi durant la nuit - pendant que les
algues symbiotiques restituent du gaz carbonique - plus vite que les coraux
asymbiotiques (Simkiss 1964). La croissance nocturne peut s'expliquer
par le besoin permanent en phosphates des zooxanthelles. Surtout les polyphosphates
à chaîne longue empêchent déjà en très
faibles quantités la précipitation du calcaire d'une solution
en sursaturation. Les zooxanthelles divisent les polyphosphates enzymatique
ment et absorbent les phosphates, pour les utiliser pour leur croissance.
Ainsi ils contribuent nettement à la croissance du squelette. Selon
les connaissances les plus récentes la croissance nocturne doit
même prédominer.
Si cependant la présence de phosphates est à profusion dans
l'eau de l'aquarium, les zooxanthelles n'ont plus de grande faim pour
les phosphates et dans les zones de formation du squelette des scléractiniaires
restent des phosphates, qui se déposent comme cristaux calcaires
empêchant leur croissance. Ainsi en présence d'un excédent
de phosphates on arrive à la régression de la croissance
des scléractiniaires si souvent observée. Cette situation
doit naturellement être évitée dans l'aquarium.
Stratégies d'élimination des phosphates
Pour ce faire, il est possible d'utiliser plusieurs moyens et stratégies.
On peut soit éviter, soit éliminer les phosphates. Afin
d'éviter une concentration de substances nutritives anorganiques
dans l'aquarium récifal, on maintient le plus souvent relativement
peu de poissons de petite taille. On privilégie les espèces
qui couvrent une partie de leurs besoins alimentaires à partir
du bac, surtout sous la forme d'algues. Espérons ne plus rencontrer
la pratique qui consiste à laisser jeûner les poissons qui
ne peuvent pas se nourrir exclusivement à partir du bac.
Une autre possibilité de minimiser les excrétions du métabolisme
consiste à distribuer une nourriture particulièrement efficace.
En particulier la nourriture sèche présente parfois de très
faibles quantités de graisses, de cinq à dix pour cent seulement.
Par enrichissement de la nourriture avec de l'huile de poissons (qui contient
beaucoup d'énergie utilisable, mais peu de phosphates) jusqu'à
une quantité de lipides d'environ 25 % l'excrétion de phosphates
peut être nettement diminuée. Suite à l'importante
quantité d'énergie d'une telle nourriture enrichie la quantité
de nourriture nécessaire pour couvrir les besoins des poissons
est moins importante. Même avec la quantité de nourriture
identique l'excrétion de phosphates par les poissons est plus faible,
car la mise à profit du contenu alimentaire surtout des protéines
est améliorée.
L'enrichissement en lipides de la nourriture n'est toutefois avantageux
pour les poissons que si elle est correcte et équilibrée,
les poissons avec des dépôts graisseux supportent mieux les
situations de stress, tandis que les animaux dont les réserves
touchent à leur fin au moment d'un besoin en énergie plus
important, tombent plus facilement malades et meurent. Toutefois les précieux
acides gras polyinsaturés, dont les poissons ont besoin, sont très
sensibles à la lumière, à l'humidité et à
l'oxygène atmosphérique et se corrompent en cas de stockage
incorrect de la nourriture.
Quelques examens, qui confirment la corrélation citée entre
qualité de la nourriture et augmentation des phosphates, ont été
menés dans un aquarium d'eau douce. Bien que l'augmentation des
phosphates se passe de manière plus abrupte dans les aquariums
d'eau douce en raison d'une décoration (fixatrice de phosphates)
plus faible, le cycle des phosphates est fondamentalement le même
dans les aquariums d'eau de mer.
L'excrétion de substances nutritives moins importantes par les
animaux d'aquarium a une influence apparemment plus faible sur la proportion
azote-phosphore dans l'eau de l'aquarium. En outre, il existe le danger
dans des bacs récifaux que les phosphates se concentrent unilatéralement,
car dans presque chaque bac plus âgé des quantités
non négligeables de nitrates sont éliminés en permanence
par la dénitrification. En présence d'un réacteur
à calcaire basé sur du sable de corail, le déséquilibre
azote-phosphore peut encore s'aggraver. Une offre en azote suffisante
constitue cependant la condition pour l'appétit en phosphates des
zooxanthelles.
Ici s'applique l'équilibrage des substances nutritives par l'apport
d'azote. L'ajout d'azote sous la forme de nitrates est largement répandu
de nos jours dans l'aquariophilie récif ale. J'ai moi-même
toujours préféré les combinaisons azotées
organiques, parce que la dénitrification ne peut se produire qu'après
la division et la nitrification de l'ammonium et certaines de ces combinaisons
peuvent être mieux utilisées que les nitrates. Une bonne
offre en azote augmente la consommation en phosphates des zooxanthelles
et la croissance des coraux. Ainsi on a pu diminuer les phosphates jusqu'au
point où les cyanobactéries ne pouvaient plus croitre. Hélas,
la croissance des algues calcaires rouges et des scléractiniaires
à gros polypes ont également souffert du manque de phosphates.
En présence de ces conditions, la croissance des scléractiniaires
à petits polypes se trouve diminuée, mais elle est très
trapue et régulière.
Une autre possibilité de déplacer l'équilibre en
faveur de l'azote, est l'élimination des phosphates de l'eau par
précipitation ou adsorption. La méthode la plus ancienne
de précipitation des phosphates est représentée par
la méthode du Kalkwasser de Peter Wilkens. L'augmentation de pH
qui se produit précipite une partie des phosphates dissous. Hélas,
ils se déposent sur le décor et le substrat et forment ainsi
des dépôts de phosphates permanents, qui peuvent être
consommés par les algues benthiques et les cyanobactéries.
Apparemment les cyanobactéries sont capables de dissoudre et d'absor-
ber les phosphates par l'excrétion de substances organiques. Avant
toute chose ces dépôts peuvent créer un problème
lorsqu'on passe à une autre méthode d'addition de calcium.
Les phosphates passent alors de nouveau partiellement en solution.
Au cours des dernières années d'autres moyens de précipitation
ont été mis en oeuvre avec plus ou moins de succès
comme les sels à base de fer. En principe ils ont le même
inconvénient que l'hydroxyde de calcium. On aspire au moins régulièrement
tous les dépôts non fixés dans le sol, pour de cette
manière au moins éliminer de l'aquarium une partie des phosphates
précipités.
Nettement plus pratique est l'élimination des phosphates au moyen
de granulats adsorbants. Tous les adsorbeurs que j'ai pu tester possédaient
des effets secondaires, qui sont souhaitables ou indésirables.
Ainsi les substances jaunes sont rapidement retirées de l'eau,
ce qui conduit à une modification rapide des conditions lumineuses.
Si cela se produit de manière trop abrupte dans des bacs fortement
chargés en substances jaunes, ceci peut avoir des conséquences
néfastes pour les coraux: étant donné qu'un rayonnement
lumineux plus important et une diminution des phosphates vont de pair,
ils mènent à une double charge des coraux. Dans ce cas aussi
ce sont les coraux à gros polypes qui sont les plus sensibles.
L 'hydroxyde de fer au moins, l'un des adsorbeurs de phosphates préférés,
est en mesure de fixer des quantité importantes de métaux
lourds (par exemple le cuivre et le manganèse) et conduit ainsi
à un déficit en oligo-éléments. Il convient
donc de prêter une attention particulière à l'addition
d'oligo-éléments (Une utilisation couronnée de succès
d'hydroxyde de fer pour éliminer une charge en cuivre de l'eau
de l'aquarium, par exemple suite à des résidus médicamenteux
ou de pompes défectueuses, n'a pas été essayée
à ma connaissance).
Toutes ces mesures peuvent conduire à terme à un sous approvisionnement
en phosphates. Dès 1995 j'ai constaté que malgré
une addition correcte d'oligo-éléments les scléractiniaires
d'un bac dépourvu de poissons présentaient des troubles
carentiels : les animaux étaient nettement plus clairs, croissaient
à peine et s'ouvraient très peu. Je l'ai attribué
à une carence en macro substances nutritives et me suis décidé
à ajouter une combinaison azotée et polyphosphatée.
J'ai respecté une proportion azote-phosphore entre 20 :1 et 25
:1.
Ceci en fonction du souhait d'une proportion dérivée d'après
une croissance limitée par les phosphates (en suivant l'exemple
de la proportion dite de Redfield de 16 : 1) s'est révélé
comme très propice. Les troubles carentiels ont été
supprimés en quelques jours après l'addition de substances
nutritives. Par la suite, il s'est révélé que la
croissance des cyanobactéries était la plus faible avec
ce ratio et que par contre elle augmentait avec une proportion azote-phosphore
de 30 : 1. Comme cause, je présume que les cyanobactéries
ont la capacité de s'approprier les phosphates de manière
particulière.
La croissance de tous les coraux y compris Acropora spp., était
à ce moment là particulièrement luxuriante et saine
et les espèces à gros polypes (Trachyphyllia, Catalaphyllia
et autres) s'épanouissaient et offraient un spectacle magnifique.
La coloration des coraux (espèces sauvages) était pour la
plupart excellente et presque toujours meilleure qu'au moment de l'acquisition.
Il n'y eut pas de perte et même les coraux qui semblaient être
des candidats à la mort chez les commerçants ont pu être
parfaitement acclimatés. Des boutures de quelques centimètres
de longueur mises en place par la suite ont poussé sans cesse.
Toutefois la croissance des espèces du groupe Acropora humilis
trapues, que j'apprécie particulièrement, s'est poursuivie
de manière irrégulière et lâche. Particulièrement
la forme de l'espèce Acropora gemmifera est devenue assez
peu naturelle et d'aspect peu esthétique. La conservation de filtreurs
de plancton comme une huître "crête de coq" Lopha
cristagalli et le genre Dendronephthya réussissaient
parfaitement à cette époque.
Malheureusement ces succès n'ont pas duré longtemps, lorsque
j'ai essayé d'augmenter la dureté carbonatée entre
10 et 11°KH. Ceci a conduit durant deux années à la
stagnation et à des pertes. Après avoir quitté cette
fausse piste, j'ai de nouveau "travaillé" avec une dureté
carbonatée de 8°KH. Par la suite des analyses de meilleure
qualité m'ont permis de contrôler avec plus de précisions
d'autres paramètres importants de l'eau comme la quantité
de phosphates.
J'ai alors commencé par diminuer la quantité de phosphates
par un apport mal équilibré d'azote, afin par ce moyen de
combattre les cyanobactéries qui commençaient à s'étendre
en certains endroits. Avec quelque patience et persévérance
ceci a finalement réussi. La plupart des coraux surtout le corail
corne de cerf, a pu s'adapter graduellement à la diminution des
phosphates. Leur croissance et leur coloration étaient pour la
plupart satisfaisants. Les coraux durs à gros polypes ne déploient
plus hélas leur splendeur passée et végètent
comme les algues calcaires rouges.
Par l'arrêt des conditions de croissance limitées par les
phosphates j'ai essayé de renouer avec les succès antérieurs
et de restituer les bases pour la conservation de filtreurs de plancton.
J'ai réussi la mise en place d'un vaste banc de copépodes
dans le bac de filtration d'un aquarium très pauvre en phosphates.
Cependant un genre de Dendronephthya n'a pu être conservé
sur le long terme. Des coraux récemment acquis ont également
posé problème. Pour eux une augmentation de la quantité
de phosphates de 0.01 à 0.05 milligrammes par litre aurait été
très utile.
D'autre part les coraux du groupe Acropora humilis ont développé
une croissance très régulière et proche de l'aspect
d'origine. Pour la forme de croissance extrêmement compacte que
ne présente dans la nature que les pieds situés directement
sous la surface de l' eau il manquait essentiellement le rayonnement lumineux
provenant de tous côtés.
Indicateur pour l'approvisionnement en phosphates
Les coraux ne doivent pas être brun foncé mais légèrement
éclairci sans toutefois trop blanchir. La croissance est alors
très lente, mais robuste. Des modifications très rapides
de la quantité de phosphates sont à craindre lors de la
mise en œuvre d'adsorbeurs de phosphates. Les pierres calcaires du décor
ainsi que le substrat représentent un tampon phosphate très
efficace qui, en fonction de la valeur du pH et de la quantité
de phosphates de l'eau, absorbe ou rend des phosphates. Une modification
visible des phosphates disponibles pour les coraux ne peut être
effective qu'après plusieurs semaines. Dans l'ensemble la conservation
des coraux en présence de conditions extrêmement pauvres
en phosphates correspond à une randonnée en arêtes.
Sorokin, qui a écrit un livre fascinant à propos de l'écologie
des récifs de corail, indique comme valeur inférieure environ
0.015 milligrammes par litre PO-4 (0.16 micromol) quantité avec
laquelle une absorption nette de phosphates se fait encore par les Acropora.
Des quantités de phosphates encore plus faibles dans l'eau mènent
à des pertes de phosphates chez les coraux.
Ce sont les espèces des genres Acropora et les coraux cerveaux
de la crête récifale qui s'en sortent le mieux avec de telles
conditions extrêmes. Pour l'aquariophile engagé qui voudrait
abandonner ces belles espèces à leur lente croissance sans
être dérangé, cette manière de conservation
des coraux dans un aquarium spécial me semble valoir les efforts.
Je pense que de tels aquariums spéciaux représentant un
petit extrait réaliste du biotope d'un récif corallien offrent
plus de possibilités et de connaissances qu'une collection de scléractinaires
colorés. La lecture de Veron & Norwood (1986) apporte suffisamment
d'informations et d'inspirations.
Littérature
Kohl, J.-G. & A. Nicklisch (1988): Ökophysiologie der Algen :
Wachstum und Ressourcennutzung. Stuttgart, New York.
Luther, T, & E. Pawlowsky (1997, 1998, 1999) : Stichwort "Phosphat".
Das Aquarium 31 (11): 40-46; 32 (2): 38-41; 32 (4): 38-44; 33(5): 35-40;
33 (7): 40-43.
Pawlowsky, E. (1999): Magnesium im Riffaquarium. D. Aqu. u. Terr. Z. (Datz)
53 (.12): 20-25.
Schreckenbach, K., & H. Wedekind: Umwelt und Ernährungseintfüsse
aIs Wegbereiter für Fischkrankheiten. ln: Wedekind, H. (Hg): Fischkrankheiten.
EAFP- Schrift zur Tagung der Deutschen Sektion der European Association
of Fish.
Pathologists (EAFP) am 19.-21 September 2000 in Potsdam, Brandenburg.
Simkiss, K. (1964): Phosphates as crystal poison of calcification. Biol.
Rev. 39:487-505.
Sommer, U. (1994): Planktologie. Berlin, Heidelberg.
Sorokin, Y.I. (1995): Coral Reef Ecology. Ecological Studies 102. Berlin,
Heidelberg, New York.
Steffens, W. (1985): Grundlagen der Fischernährung. Jena.
Veron, J. & E. Norwood (1986): Corals of Australia and the Indo-Pacific.
North Ride, Australien.
 L'auteur
L'auteur
Hans-Werner Balling, 37 ans, assistant technique pour les musées
et instituts d'histoire naturelle. S'est occupé de 1987 à
2000 des aquariums du Jura Museum à Eichstätt. Responsable
produits depuis 2001 chez Dr. Biener GmbH (Tropic Marin)
