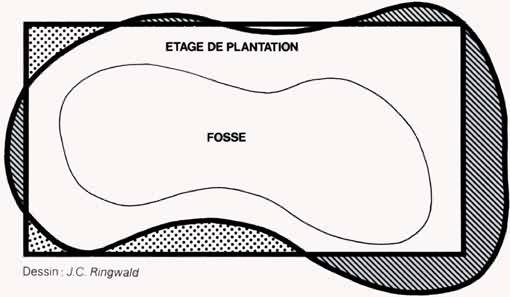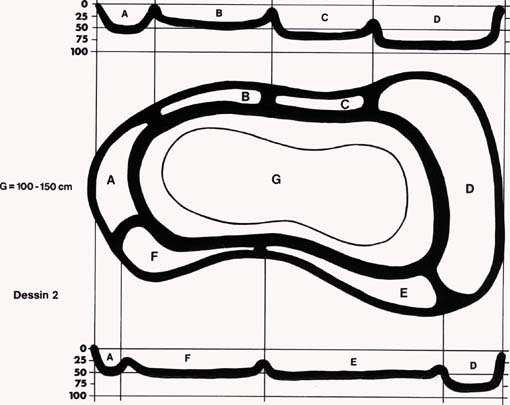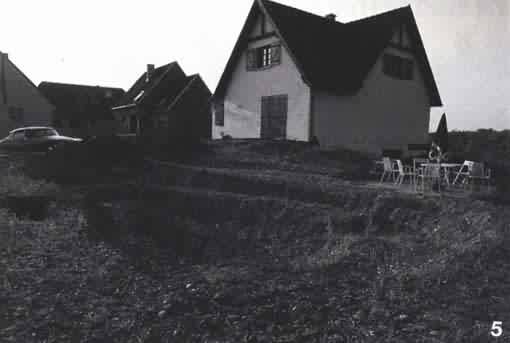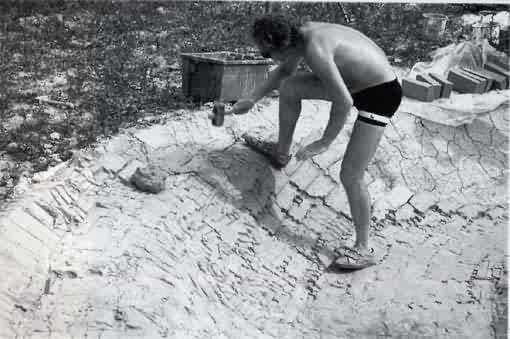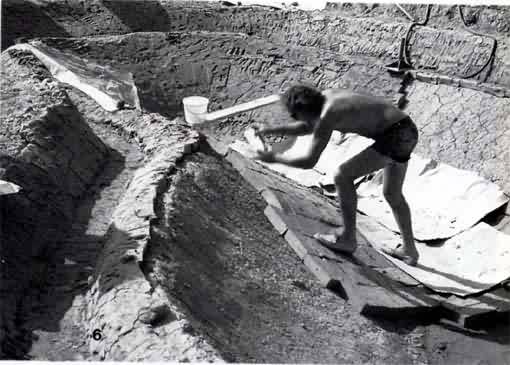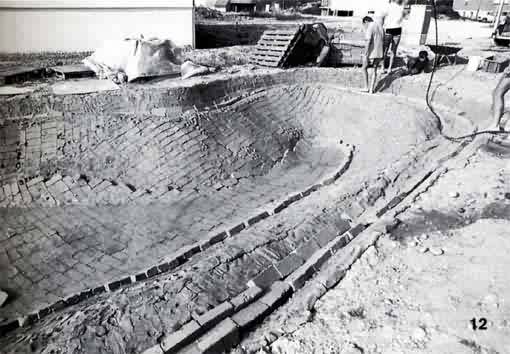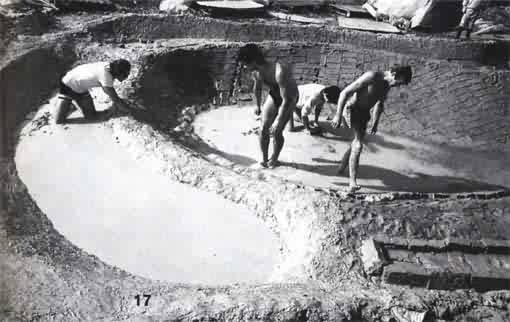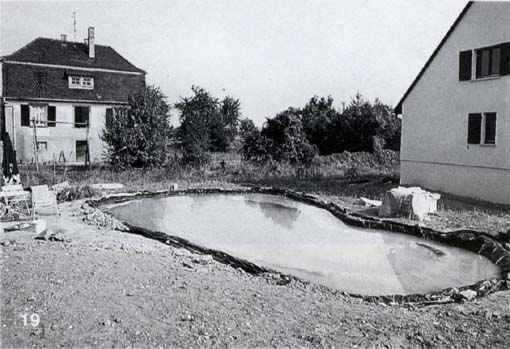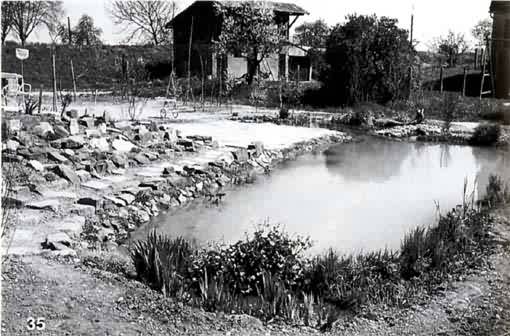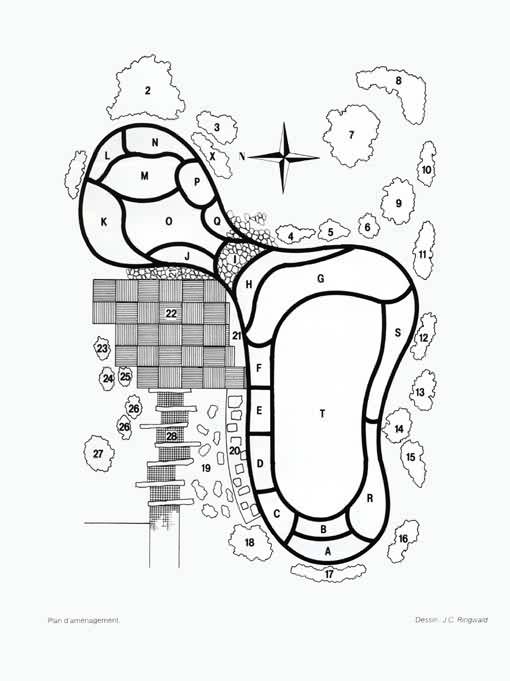CONSTRUCTION
D'UN BASSIN DE JARDIN DE 50 000 LITRES
CONSTRUCTION
D'UN BASSIN DE JARDIN DE 50 000 LITRES
par Jean Claude RINGWALD (1986)
Divers matériaux peuvent être envisagés pour la
construction d'un bassin de jardin. Parmi les plus courants on prendra
une option pour l'une des formules suivantes : le béton (de préférence
armé), la résine de polyester associée au mat de
verre et enfin les films d'étanchement qui peuvent éventuellement
être associés à de l'argile.
 |
| Une
vue du bassin deux ans après sa mise en eau. Photo : J. Teton |
Passons rapidement en revue les divers matériaux cités.
1 - Le béton : il présente l'avantage, s'il est correctement
préparé (adjonction d'hydrofuges, armement, etc...) d'être
indestructible. Toutefois son coût et celui de la mise en oeuvre
(coffrage) posent des problèmes complexes à l'amateur qui
désire fabriquer son bassin par ses propres moyens. De plus la
mise en place d'un coffrage simple empêche généralement
à des bassins de ce type d'avoir des formes naturelles et il faut
l'avouer, dans ce cas, le bassin risque souvent de ressembler plus à
une piscine qu'à un point d'eau. Enfin au-delà d'un volume
de 10-20 mètres cubes, la construction d'un bassin en béton
est tout simplement ruineuse.
2 - La résine de polyester : ce matériau très en
vogue est utilisé par de nombreux fabriquants pour satisfaire les
amateurs de bassin désireux d'installer une zone aquatique avec
le moins d'efforts possibles. Pratiques, ils sont rapidement installés,
mais leur volume est généralement limité. Celui qui
désire avoir un bassin de grande taille pourra toutefois le construire
aux dimensions de son choix à l'aide de ce matériau qui
présente l'avantage par rapport au béton de pouvoir créer
des formes plus irrégulières et donc plus naturelles. Pour
des bassins de très grande taille, hélas, la solution de
la résine de polyester associée au mat de verre devient
elle aussi rapidement inabordable.
3 - Les films d'étanchement. Ces dernières années
un certain nombre de fabricants proposent des films en plastique armé
(Vitakraft, Tetra, etc...) ou en matière imputrescible (Plastoplan).
Ces films permettent une mise en place relativement peu onéreuse
de bassins de jardin de taille moyenne. L'utilisation d'un film en polyéthylène
associé à une couche d'argile (la conception a été
décrite dans Aquarama N° 46 et 47) reste toutefois le procédé
le moins cher pour les amateurs préférant avoir recours
à l'huile de coude plutôt qu'aux dernières réserves
du livret d'épargne. C'est ce procédé que j'ai retenu
pour la réalisation d'un bassin de 50 000 litres. Toutefois avec
un tel volume en perspective certaines mesures de sécurité
sont à prendre. De plus étant donné la grande surface
de terre qu'il faudra rendre étanche il est impensable de pratiquer
cette construction de la même manière car il serait trop
fastidieux de malaxer les dizaines de mètres cubes nécessaire
pour recouvrir les parois du bassin.
CONSTRUCTION DU BASSIN
I - L'EXCAVATION
Pour creuser la fosse d'un grand bassin il est préférable
de faire appel à une entreprise possédant une petite excavatrice.
Les paysagistes possèdent souvent ce type de matériel qui
ne cause pas des dégats trop importants dans des jardins déjà
aménagés. Dans le cas où la configuration du jardin
(plantation, bâtiments, etc...) ne permet pas l'usage d'un tel engin
(aussi petit qu'il soit) il ne vous reste qu'à faire appel aux
membres de votre famille ou à tous vos amis (en espérant
qu'ils soient nombreux à répondre...) Dans le cas ou vous
êtes en pleine construction profitez de la présence des bulldozers
qui font les fouilles de votre future habitation. C'est d'ailleurs le
moment le plus judicieux pour prévoir l'aménagement d'un
bassin de grande taille. Il est évident que ces engins ne vous
feront pas des pourtours sinueux, ce travail restant à votre charge
; néanmoins le déplacement de 40 à 50 mètres
cubes de terre n'étant pas une mince affaire, on saura apprécier
ultérieurement le travail ainsi évité. La fosse sera
creusée initialement à la profondeur définitive.
En ce qui concerne la longueur et la largeur de la fosse, il conviendra
d'excaver seulement entre cinquante et soixante pour cent des dimensions
définitives. Les pourtours et les étagements extérieurs
se faisant manuellement à l'aide de pioches et de pelles. Ce travail
vous semble fastidieux, mais sachez qu'il peut se faire par une seule
personne à condition d'y passer une bonne partie de ses congés
et de ses fins de semaine (et je sais de quoi je parle !). Pour un bassin
de grande taille il est inutile de prévoir le contour dans ses
détails, une forme générale avec plus ou moins d'arrondis
tel que nous le voyons sur le dessin est largement suffisante. Les fioritures
se feront au fur et à mesure des travaux, et en particulier vers
la fin, lorsque la forme du bassin prendra une certaine allure. Le présent
article étant également largement accompagné de photographies
vous n'aurez aucun mal à vous y retrouver.
Il - L'ARGILE
La propriété fondamentale de l'argile est d'être imperméable
à l'eau. Pour avoir la certitude que le matériau choisi
est bien de l'argile il convient de s'assurer que les divers paramètres
qui suivent soient tous réunis. La couleur est fort variable puisqu'elle
comporte les teintes suivantes : noire, bleue (parfois panachée
de rouge et de gris), jaune (la plus commune), verte, blanche (Kaolin)
et grise. Il s'agit d'une roche tendre qui se raye facilement lorsqu'on
la gratte avec l'ongle. Son contact rappelle celui du savon car elle est
onctueuse au toucher. En mélangeant un peu d'argile avec de l'eau,
celle ci se trouble rapidement et prend la couleur de l'argile. Une multitude
de petites particules sont en suspension dans l'eau et celles-ci ne se
sédimentent qu'au bout de plusieurs heures, voire quelques jours
ou même plusieurs semaines. Les particules d'argile contiennent
des pores microscopiques qui ont la particularité de retenir l'eau.
Ainsi lorsqu'elles se gonflent, les pores disparaissent, et la roche devient
imperméable. Lorsque l'eau s'évapore, l'argile se rétracte.
Tout le monde a pu observer durant la saison estivale des sols craquelés
qui signalent une importante présence de cette roche. Toutefois
pour assurer une étanchéité parfaite, l'argile doit
être aussi pure que possible. Pour vérifier la pureté
de la roche il suffit d'y verser de l'acide chlorhydrique ; à ce
moment il ne doit se produire aucune effervescence. L'étalement
de la couche d'argile sur les parois du bassin se fera en choisissant
l'une des deux méthodes suivantes :
- Malaxage de l'argile brute avec de l'eau tel que M. J. TETON l'a décrit
dans Aquarama N° 46. Cette méthode, facilement réalisable
pour des petits bassins (moins de 10 000 litres), devient impensable pour
des volumes plus importants étant doné le caractère
herculéen de la tâche. De plus pour d'importants volumes
d'eau, il est impératif de s'assurer d'une couche minimale d'argile
répartie de façon régulière sur les parois
du bassin (minimum 5-7 centimètres), épaisseur aléatoire
à réaliser à la main sans des sondages fréquents
qui prennent également une part importante du temps de travail.
- Création d'une couche d'étanchement à l'aide de
briques d'argile crue (et si possible encore humide) achetées chez
le briquetier local. La taille idéale des briques se situant aux
environs de 20 centimètres (une épaisseur supérieure
n'est pas préjudiciable, au contraire). Avant de commander les
briques il est toutefois préférable de respecter les critères
précédemment décrits pour s'assurer de la qualité
des briques d'argile. Il est également impératif que la
livraison des briques crues soit aussi rapide que possible afin que celles-ci
n'aient pas le temps de sècher (s'il fait trop chaud) ou de former
une masse pâteuse (si le temps est à la pluie). Il est également
recommandé de demander au fabricant de livrer les briques sur des
palettes recouvertes d'une protection en carton ou d'un film en polyéthylène,
ceci pour conserver aussi longtemps que possible la maléabilité
du matériau.
III - CHOIX DU FILM PROTECTEUR
En priorité il conviendra de choisir un film en polyéthylène
de couleur noire. En effet, par rapport au film transparent, celui-ci
est beaucoup plus résistant au rayonnement des U.V. solaires. De
plus cette couleur "passe mieux" lorsque les berges deviennent
visibles à cause d'une éventuelle baisse du niveau de l'eau
(évaporation par exemple). D'une manière générale
il conviendra également de choisir un film de la plus grande épaisseur
existante, puisqu'il en résultera une résistance plus performante
par rapport aux accidents de déchirure toujours possible. Toutefois
ce risque ne doit en aucun cas vous obnibuler, car le rôle du film
n'est pas à proprement parler de rendre le bassin étanche,
mais d'empêcher la couche d'argile de se liquéfier avec le
contact de l'eau et de s'écouler au fond du bassin. De petites
déchirures sont en principe sans conséquence pour l'étanchéité
du bassin. Le choix du polyéthylène (allié à
une couche d'argile) réside dans le fait que celui-ci ne présente
aucun caractère toxique et évite tout rinçage avant
le remplissage du bassin, ce qui n'est pas le cas du béton ou de
certaines résines. Le rinçage ne présente pas de
problèmes pour de petits bassins, mais si le volume dépasse
20 000 litres cette opération signifie une dépense appréciable.
Pour terminer on peut également apprécier la résistance
de ce matériau par rapport au gel (40° C) et aux fortes températures
(+ 50°C). L'achat du rouleau de film en polyéthylène
devra se faire avec précaution, car si l'on se rend compte lors
de sa mise en place que le film est trop court tant au niveau de la largeur
que de la longueur, on peut se préparer à faire des collages
de bandes à l'aide d'un rouleau de scotch à double face
adhésive et résistant à l'eau. Pour éviter
toute surprise il vaut donc mieux dès le départ prévoir
les dimensions nécessaires en ajoutant à la longueur et
la largeur du film la dimension équivalent à deux fois la
profondeur du bassin plus une marge de sécurité de cinquante
centimètres pour chaque côté. Ainsi si votre bassin
comprend dans ses dimensions maximales une longueur de 15 mètres,
une largeur de 8 mètres et une profondeur de 1,5 mètre,
les dimensions minimales de la feuille de polyéthylène seront
de 19 mètres de long et de 12 mètres de large. Pour votre
gouverne, les dimensions les plus courantes proposées par les fabricants
sont des rouleaux de 10, 25 ou 50 mètres de long pour 3, 4, 6,
9, 10 ou 12 mètres de large. Notez également que selon les
fabricants certaines de ces dimensions ne sont livrées que sur
commande et qu'il vaut donc mieux prévoir les délais de
livraison lors de la planification de l'ouvrage.
IV - REALISATION
Après avoir étudié le côté théorique
de la conception du bassin, vous avez maintenant en main tous les éléments
nécessaires à sa réalisation. Pour vous permettre
de concrétiser au mieux cette phase des travaux, l'article sera
illustré d'une manière aussi abondante que possible.
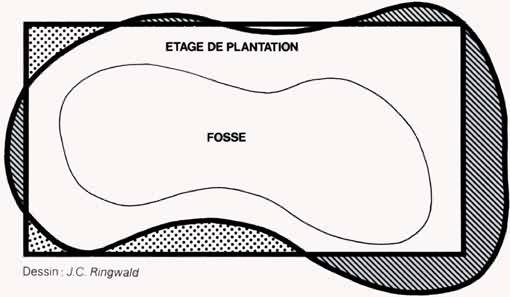 |
Dessin 1 : Plan de masse comportant la fosse à partir de laquelle
seront creusés sur les côtés les zones d'élargissement
(en hachuré) et les remblaiements éventuels (en pointillé).
Si l'on ne fait pas appel aux engins mécaniques on pourra faire
un plan de travail basé directement sur le dessin N° 2.
Dessin 2: II est important dès le départ de planifier
les zones d'étagement abritant la végétation. On
gèrera ainsi mieux les espaces de plantation en prévoyant
immédiatement la plus grande variété d'espèces
possible. De cette manière on évitera également des
surprises toujours désagréables (envahissement du bassin
par les espèces particulièrement prolifiques).
Photo 1 : En raison de la végétation installée
ultérieurement (en particulier les Nymphaea) il vaut mieux
prévoir une implantation du bassin dans une zone aussi ensoleillée
que possible. Le traçage de la fosse, profonde environ de un mètre
à un mètre cinquante, sera délimitée à
l'aide d'une ficelle enroulée autour de quatre piquets.
Photo 2 : Cette zone sera ensuite excavée à l'aide d'un
Bulldozer si le jardin n'est pas encore aménagé (On remarquera
à l'arrière de la fosse, les débuts des travaux d'étagements).
Photo 3 : Ce chat nous donne une petite idée des dimensions ultérieures
du bassin.
Photo 4 : La fosse initiale est creusée sur les côtés
que l'on désire élargir. La terre ainsi déblayée
sera versée dans les zones que l'on désirera rendre plus
étroites (revoyez le dessin N° 1 pour une meilleure visualisation
des informations). On remarquera les divers étages ainsi créés.
Ceux-ci seront diversifiés tant du point de vue de leur dimensions
que de leur élévation. De la réalisation de ces zones
biologiques dépendra ultérieurement le succès des
plantations.
Photo 5 : Comme je le disais, cette phase de travaux peut être
accomplie par une seule personne. Cela engendre naturellement une relative
durée dans le temps comme l'atteste la croissance de la verdure
qui devra bien entendu être éliminée ultérieurement.
Photo 6 : Les étages de faible profondeur (20 à 30 cm)
seront réservés aux plantes de berges humides telles que
les Massettes, les Phragmites (roseaux), les Scirpes, les Iris, la Renoncule
aquatique ou encore l'Arum des marais.
Photo 7 : Les étages de moyenne profondeur (30 à 60 cm)
abriteront les plantes aquatiques proprement dites : Myriophyllum,
Elodea, etc... Ce type de végétation n'est pas toujours
spectaculaire mais sa présence est impérative dans tout
bassin de moyenne ou grande taille. Elle permet en premier lieu d'épurer
l'eau ; en second, elle favorise l'oxygénation de celle-ci. Ce
facteur est surtout nécessaire durant la période estivale
lors des élévations de température. Cette profondeur
est également appréciable pour la plantation de végétaux
tropicaux tels que les Lotus qui demandent à être sortis
durant la mauvaise saison (il est plus facile de retirer des végétaux
dans 50 cm d'eau qu'à un mètre ou un mètre et demi
de profondeur)
 |
Photo 8: L'aménagement d'un paludarium peut également
être envisagé. Celui-ci pourra être construit ultérieurement
comme nous le voyons sur la photographie. Cette zone pourra abriter des
plantes tels que les Hyperycum les Arums d'Ethiopie, les Pontederia cordata,
bref toutes les plantes aimant les zones marécageuses.
Photo 9 : Pour travailler la terre qui est souvent très dure
(surtout en été) il est préférable d'humidifier
le sol et de le rendre boueux.
Photo 10 : On peut ainsi rendre les parois extrêmement lisses,
ce qui facilite la pose ultérieure de la couche d'argile.
Photos 11 et 12 : Nous voyons ici la phase lissée de deux extrémités
du bassin dans leur détail. Comparez les avec les photos 6 et 7
dans leur état brut pour vous faire une idée du travail
à accomplir.
Photo 13 : Le sol dans lequel est aménagé le bassin contient
déjà une importante proportion d'argile. On retiendra sa
perméabilité et également son aspect craquelé
dans les zones qui se sont dessèchées (voir également
photo 20).
Photo 14 : Vue générale du bassin lorsque les travaux de lissage
sont terminés. Cette phase de la construction est très importante
car elle détermine l'uniformité de la couche d'argile pure.
Photos 15-16 : Arrivée du chargement. Les briques crues gorgées
d'eau sont relativement lourdes. La masse est instable à cause de
la maléabilité de l'argile. Le déchargement doit se
faire avec beaucoup de précautions.
Photo 17 : Le détail d'une palette. Il est très important
de demander au fabricant de séparer les différentes couches
de briques par des feuilles de polyéthylène ou de carton.
Si cette mesure n'est pas prise, le poids respectif des briques provoquerait
le tassement des couches inférieures et risquerait de former une
masse compacte difficile à travailler ultérieurement.
Photo 18: Pour éviter tant le dessèchement de l'argile
(lorsqu'il fait trop chaud) que la réduction des briques en une
masse informe (en cas de pluie), il vaut mieux couvrir immédiatement
les palettes de bâches ou de feuilles de polyéthylène.
Photos 19-20 : Vue de détail des briques. Lorsqu'elles sont gorgées
d'eau, les briques sont lourdes et maléables ce qui rend leur manipulation
malaisée. Les dimensions idéales pour un travail rapide
sont de 20 x 10 x 7 cm.
 |
| Vue du bassin
sous un autre angle. Photo : J. Teton |
Photos : 1-2-10: J.C. Ringwald, 3 à 9 et 11 à 20: J. Teton
Cette phase des travaux ne pourra que difficilement se faire seul à
moins de disposer de beaucoup de temps libre. Moins fastidieuse que la
conception de la fosse et des parois elle demande toutefois une certaine
minutie. Pour des petits bassins on peut commencer par le bas de la fosse,
le travail se faisant assez rapidement. Toutefois pour de grands bassins
il est préférable de commencer la pose des briques d'argile
crue sur les étages supérieurs. Il est en effet préférable,
si le temps est pluvieux, d'éviter le contact direct de l'argile
avec la nappe d'eau qui se formera inévitablement au fond du bassin
créant ainsi une masse de boue lourde dans laquelle il est très
pénible de se déplacer.
REMARQUE IMPORTANTE
Dans les zones rurales récemment habitées, la faune souterraine
est particulièrement abondante. Diverses espèces de rongeurs,
les taupes, certaines espèces d'insectes (surtout les courtillières),
par leurs travaux de fouissage peuvent creuser des galeries jusqu'à
votre bassin. Capables de percer d'abord votre couche d'argile, ensuite
votre feuille de polyéthylène, ils risquent de provoquer
une fuite temporaire allant de quelques heures à plusieurs jours.
La couche d'argile ou contact de l'eau ramollira et finira par colmater
la fuite. Il faudra alors remplacer l'eau ainsi perdue. Toutefois on peut
éviter cet inconvénient en plaçant entre les parois
du bassin et le tapis de briques d'argile un fin grillage du type moustiquaire.
 |
 |
Photos 1-2 : Les briques d'argile sont placées les unes à
côté des autres comme on le ferait pour des pavés
autoblocants.
Photos 3-4 : Les briques sont comprimées à l'aide d'un
marteau afin que les joints se soudent et que les briques ne forment plus
qu'une seule masse très compacte. On peut éventuellement
utiliser une dame à moteur comme on le fait pour tasser des pavés
autoblocants. Il faudra toutefois poser des grands cartons ou des feuilles
de polyéthylène sur l'argile afin que celle-ci ne colle
pas à l'appareil. Sachez toutefois que si cette opération
est plus rapide dans son ensemble elle est néanmoins pénible
sur les pentes abruptes des parois du bassin.
Photos 5-6 : Pour éviter des déplacements fréquents
il est préférable de se faire assister par un partenaire
qui vous lance les briques. Dès qu'on a attrapé une brique
on la positionne et on attend la suivante. On prend d'ailleurs rapidement
le pli et on progresse alors d'une rapidité remarquable dans la
mise en place de la couche d'argile.
Photos 7-8 : Lorsque le fond de la fosse est boueux, il est préférable
d'étaler de grands cartons pour répartir le poids du corps.
On conservera ainsi le fond lisse ce qui est très important pour
la répartition de la couche d'argile.
Photo 9 : Vue du bassin lorsque les briques sont entièrement posées.
On remarquera que sous l'action de la chaleur les briques se sont rétractées
et laissent apparaître des interstices qui devront être impérativement
comblés.
Photo 10 : On remplira à cet effet les divers étagements
de briques qui seront entièrement recouvertes d'eau. Leur disposition
n'a guère d'importance puisque lorsqu'elles seront bien imbibées
d'eau. Ces briques seront malaxées pour être réduites
à l'état d'une pâte onctueuse.
Photo 11 : Pour cette phase des travaux, on pourra également
utiliser les chutes de briques crues.
Photos 12 à 14 : Ces diverses vues du bassin vous donnent une
idée de la quantité de briques à utiliser. En ajoutant
l'eau il est préférable d'arroser en même temps la
totalité de la couche d'argile afin que le "crépissage"
s'amalgame bien à cette dernière.
Photo 15-16: Lorsque la deuxième couche de briques sera bien
molle, il est très facile de pétrir l'ensemble en le piétinant.
Photos 17-18 : La pâte ainsi formée sera étalée
sur toute la surface du bassin comme on le ferait pour du crépissage.
Les meilleurs outils restant encore l'usage des seaux et des mains. Les
seaux seront remplis de cette pâte qui sera versée, puis
étalée à la main sur les parois.
Photos 19-21 : Pour vous permettre d'apprécier le travail à
accomplir, vous avez ici diverses vues du bassin une fois que le crépissage
est terminé.
 |
Vues : sur le
paludarium (en bas à gauche), sur la terrasse de caillebotis
(à droite), sur le gué reliant le paludarium au bassin
(au milieu à gauche) et sur le bassin (en haut).
Photo : J. Teton |
VI - POSE DE LA FEUILLE DE POLYETHYLENE
Nous entamons maintenant la dernière phase des travaux de construction.
C'est aussi la plus facile. Toutefois pour des raisons pratiques il vaut
mieux se faire aider par quelques amis, surtout lorsqu'il y a du vent.
Si celui-ci est trop violent, il vaut mieux s'abstenir de poser la feuille
de polyéthylène, celle-ci risquant d'être emportée
(voire même déchirée), surtout lorsqu'elle est d'un
grand format.
Photo 1 : On déroule la feuille le long du bassin sur une surface
aussi lisse que possible. Les obstacles tranchants (briques ou cailloux
cassés, morceaux de bois ou de ferraille), seront impérativement
éliminés car on risque d'entailler la feuille de polyéthylène
en la manipulant.
Photo 2 : Des blocs de pierre seront placés sur les bords de la
feuille durant cette opération pour éviter que celle-ci
ne s'envole si le vent venait brusquement à se lever. De plus cette
précaution permet un déroulement plus facile du rouleau.
Photo 3 : Il faudra veiller avant la pose du polyéthylène
à ce que les parois d'argile soient bien humides. La feuille
adhèrera ainsi mieux sur celles-ci. La nappe d'eau qui se sera
formée au fond ne pose aucun problème puisqu'elle sera chassée
sur les côtés lors du remplissage du bassin.
Photo 4 : La feuille une fois déroulée et coupée
avec une marge de sécurité suffisante sera posée
par-dessus l'excavation.
Photo 5 : Il vaut mieux faire ce travail soigneusement et sans se presser,
car si la feuille est posée de travers et que l'on ne s'en rend
compte que lorsque le bassin est rempli d'eau, toute l'opération
est à refaire après vidange préalable du bassin.
Photos 6-7 : Après avoir correctement positionné la feuille
de polyéthylène on pourra commencer à remplir le
bassin.
Photo 8 : Tant que le bassin n'est pas rempli, il vaut mieux fixer les
bords de la feuille avec des objets aussi lourds que possible. Ne soyez
pas trop regardant sur les matériaux : des rondins de bois, des
blocs de pierre ou des seaux remplis d'eau feront largement l'affaire.
Cette précaution est utile pour éviter que les bords de
la feuille ne se déplacent si le vent venait à se lever
intempestivement.
Photo 9-10 : Le surplus de briques d'argile crue sera posé sur
le fond du bassin. Il servira à la fois de protection supplémentaire
contre d'éventuelles fuites et de substrat pour la plantation.
Photo 11 : Durant le remplissage il faut veiller à ce que la feuille
de polyéthylène adhère bien sur les parois afin d'éviter
des tensions inutiles qui pourraient l'étirer et donc de l'amincir,
voire déchirer en certains endroits (l'eau pèse plus lourd
qu'on ne le croit).
12 : Durant le remplissage à cause du fort courant créé
par le tuyau d'arrosage, l'eau prend la teinte de l'argile qui a été
déposée sur le fond. Rassurez-vous, elle ne gardera pas
cette couleur car au bout de quelques jours les particules d'argile se
sédimenteront et l'eau redeviendra claire.
Photo 13 - 14 : Lorsque le niveau d'eau atteint les étages qui
sont réservés à la plantation il vaut mieux arrêter
le remplissage et attendre une nuit ou deux. Cette précaution permet
à la feuille de polyéthylène de bien se positionner
et évite les risques de tension sur les bords surélevés
qui séparent la fosse des étages supérieurs.
Photos 15-16: Après cette période de repos on pourra continuer
à remplir le bassin.
Photo 17 : Comme cela a été fait pour la fosse, le fond
des étages de plantation sera recouvert d'une couche d'argile.
 |
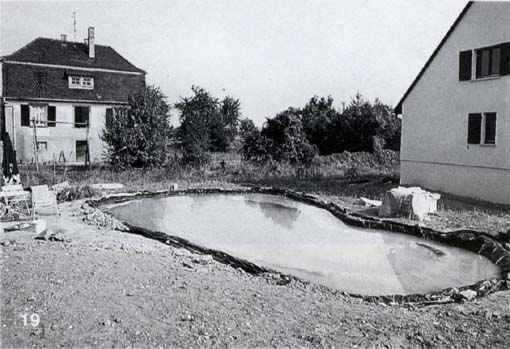 |
Photo 18-19 : Vue du bassin entièrement rempli. Il semble très
grand, mais en fait, une fois planté, seule la fosse centrale restera
bien visible.
VII - ADJONCTION D'UN PALUDARIUM
Sans être une obligation, la présence d'un paludarium est
néanmoins un apport utile à toute pièce d'eau, car
elle permet d'aumenter l'éventail des diverses espèces de
plantes qui agrémenteront le bassin. Seule une plantation riche
mettra votre bassin en valeur, les poissons n'étant presque que
des éléments secondaires de décoration. Le paludarium
pourra se faire immédiatement ou ultérieurement. Celui qui
sera décrit est en fait construit à partir d'un petit bassin
déjà existant. Il pourra soit être séparé
du bassin soit être rattaché à celui-ci.
REMARQUE : Le paludarium est un endroit idéal pour cultiver un
certain nombre de plantes tropicales. Si celui-ci est séparé
du bassin on pourra éventuellement durant la saison estivale y
introduire des poissons tropicaux pour les laisser se reproduire. Toutefois
comme il convient de rentrer tout cela durant la mauvaise saison, il est
préférable de renforcer le paludarium par une double couche
d'argile. La feuille de polyéthylène sera posée en
sandwich entre les deux couches de briques d'argile. Cette précaution
permet de patauger et piétiner sans vergogne dans le paludarium
pour y effectuer les divers travaux de plantation.
 |
Photo 20: La première couche de briques d'argile sera posée
selon le même processus décrit dans le chapître des
travaux d'étanchement.
Photos 21-22 : Après la pose de la feuille de polyéthylène,
on remplira le fond du paludarium avec de l'eau.
Photos 23-24 : La feuille de polyéthylène sera alors entièrement
recouverte de briques d'argile.
Photo 25 : La partie encore non recouverte d'argile, située presque
à ras de la surface sera comblée ultérieurement de
terreau pour réserver un petit espace aux plantes prospérant
dans des zones semi-humides.
Photos 26 à 28 : Point de jonction entre le bassin et le paludarium.
Il sera ultérieurement recouvert de galets qui renforceront cette
zone destinée à faire un gué qui permettra le passage
sans avoir à contourner le paludarium.
Photos 29 à 31:Vue du paludarium sous différents angles.
La partie centrale pourra être réservée à de
petites espèces de Nymphaéas tropicaux. L'étage supérieur
sera réservé à des plantes tropicales ou subtropicales
telles que les Pontédériacées.
Photo 32 : Une fois le travail terminé on pourra compléter
le niveau et immerger le paludarium.
Photo 33 : Vue du gué partiellement terminé. Les berges
pourront être agrémentées de souches d'arbres pour
rendre l'ensemble plus sauvage.
 |
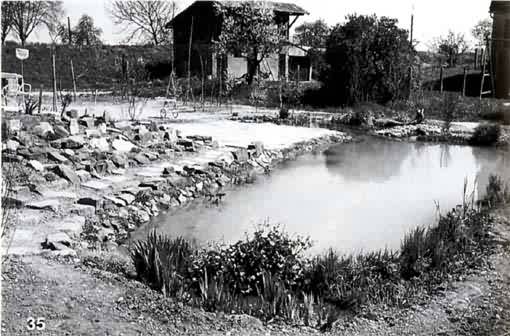 |
 |
Photos 34 à 36 :Vues d'ensemble du bassin dans son état
final. On remarquera l'ébauche d'une plantation qui sera bien entendu
complétée.
VIII - AMENAGEMENT DE LA PLANTATION
L'avantage d'un bassin de grande taille réside dans la possibilité
d'une implantation de la plus grande variété possible de
végétaux. Toutefois l'ensemble ne saurait être une
réussite pour l'oeil sans des abords aménagés avec
harmonie pour compléter le milieu aquatique. Un bassin fait partie
du jardin et ne doit en aucun cas faire penser à un milieu artificiel,
mais au contraire s'amalgamer avec ce qui l'entoure. A partir du dessin
vous pourrez élaborer cet ensemble sans bien sûr vous tenir
à la même disposition. Le présent chapître est
écrit pour vous donner une idée de disposition de plantation,
mais ne doit en aucun cas être une règle rigide. Faites également
travailler vos méninges pour apporter à votre réalisation
une touche de votre propre personnalité.
NOTA: En vous repérant sur le dessin, pour éviter toute
confusion, la liste des plantes aquatiques suit un ordre alphabétique,
la liste de l'aménagement des abords suit un ordre numérique.
PLANTATION DU BASSIN
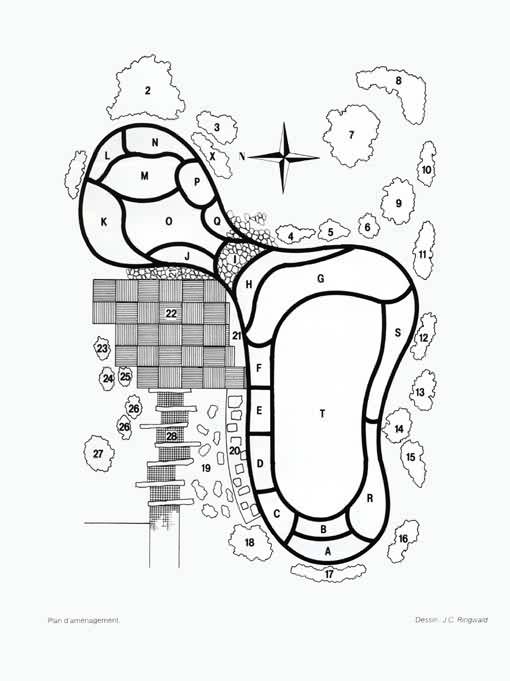 |
Pour vous permettre de mieux prévoir l'implantation des végétaux
je vous indiquerai dans l'ordre le nom scientifique, le nom commun (entre
parenthèses), la hauteur de la plante et la profondeur de plantation
en cm, la période de floraison et d'éventuelles remarques
concernant la culture. L'annotation "Plante locale" signifie
que la plante se trouve communément dans les cours d'eau de notre
pays.
A - Iris pseudoacorus (Iris des marais) ; Hauteur 70/80 ; Profondeur
d'immersion ; 0/50 - Floraison : Printemps ; Plante locale.
B - Caltha palustris (Souci d'eau) ; Hauteur : 30/40 - Profondeur
d'immersion : 10 - Floraison : Printemps ; Plante locale.
C - Iris sibirica (Iris de Sibérie) ; Hauteur : 40/60 ;
Profondeur d'immersion : 0/50 ; Floraison : mai/juin.
D - Butomus umbellatus (Butome) ; Hauteur : 70/110 ; Profondeur
d'immersion : 10 ; Floraison : été ; Plante locale.
E - Calla palustris (Arum des marais) ; Hauteur :20 ; Profondeur
d'immersion : 10/20 ; Floraison : juin/juillet ; Plante locale ; doit
être plantée dans la vase.
F - Myriophyllum brasiliensis (Myriophylle du brésil) ;
Longueur : 50/150 ; Profondeur d'immersion : 30/60 ; Plante tropicale
qui semble résister durant les hivers peu rigoureux. Toutefois
conservez quelques souches à l'abri durant l'hiver.
G - Nous abordons la fosse secondaire dont la profondeur varie entre 50
et 75 cm. Le choix de plantation se fera entre des espèces locales
ou tropicales. Les espèces tropicales devront être retirées
à la fin de l'automne et être mises à l'abri durant
la mauvaise saison :
- Sagittaria sagittifolia (Sagittaire, flèche d'eau) ; Hauteur
: 40 ; Floraison : été ; Plante locale.
- Nuphar luteum (faux nénuphar) ; Hauteur : feuilles flottantes
; Floraison : été ; Plante locale.
- Nymphaea tropicaux ; Hauteur : feuilles flottantes ; Floraison : été.
- Nelumbo (Lotus, nénuphar d'Egypte ; Hauteur : 0/30 ; Floraison
: été.
- H. Myosotis palustris (Myosotis des marais) ; Hauteur : 25 ;
Profondeur d'immersion : Zones humides jusqu'à 10 cm de profondeur
; Floraison : fin du printemps jusqu'à la fin de l'été
; Plante locale.
- I. Gué (Zone recouverte de gros galets).
- J. Alisma Ianceolatum (plantain d'eau) ; Hauteur : 20/30 ; Profondeur
d'immersion : 0/10 ; Floraison : été ; Plante locale.
K. et L. Zones semi-humides qui sont simplement en contact avec l'eau.
On pourra y mélanger les espèces suivantes :
Pour K.
- Zantedeschia aethiopica (Arum d'Ethiopie) ; Hauteur : 70/80 ;
Floraison : de la fin du printemps au début de l'automne ; Pailler
en hiver.
- Astilbe ; Hauteur : 50/70 ; Floraison : été.
Pour L.
- Lythrum salicaria (salicaire) ; Hauteur 50/130 ; Floraison :
Fin de l'été, début de l'automne selon l'humidité
du sol ; Plante locale.
- M. Acorus calamus (Acore) ; Hauteur : 50/70 ; Profondeur d'immersion
: 15 ; Floraison : fin du printemps, début de l'été
; Plante locale.
- N. Phragmites communis (Roseau) Hauteur :100/150 : Profondeur
d'immersion : sols humides jusqu'à 50 cm ; Floraison : fin de l'été
; Plante locale.
- O. Hypericus ; Hauteur : 20/25 ; Profondeur d'immersion : 0/30
; devient rapidement envahissant.
- P. Pontederia cordata ; Hauteur : 50/75 ; Profondeur d'immersion
: 10/15 ; Floraison : dès août jusqu'à octobre si
le temps est doux ; résiste mal au gel, pailler ou mettre à
l'abri en hiver. Plante subtropicale.
- Q. Juncus effusus (jonc) ; Hauteur : 40/50 ; profondeur d'immersion
: 10/20 ; Floraison : fin du printemps à août ; Plante locale.
- R. Scirpus lacustris (scirpe) ; Hauteur 100/110 ; Profondeur
d'immersion : 10/40 ; Floraison : été ; Plante locale.
- S. Typha maxima (massette) ; Hauteur : 100/120 ; Profondeur d'immersion
: Sols humides à 20 cm ; Floraison : été ; Plante
locale.
- T. Fosse profonde : Profondeur :100/150 ;convient évidemment
aux Nymphéas qui fleurissent tout l'été. Veillez
à ce que cette partie du bassin soit toujours ensoleillée.
On peut également planter dans cette zone l'Elodea canadensis
(Peste d'eau) qui est un excellent facteur d'oxygénation de l'eau
en été. Sachez toutefois que cette plante est très
envahissante.
PLANTATION ET AMMENAGEMENT DES ABORDS DU BASSIN
- 1. Miscanthus gigantheus (Euralie) ; Hauteur :100/200 ; Floraison
: Juillet à octobre.
- 2. Choix entre Salix babylonica (Saule pleureur) ; Hauteur :
600/1000 à planter seul ou un petit groupe de Salix elaeagnos
(Saule drapé) ; Hauteur : 300/400 ; Floraison : chatons en avril ; Plante
locale.
- 3. Arundinaria sinensis (Bambou de Chine) ; Hauteur : 80/150
; Floraison : très rare.
- 4. Iris kaempferi (iris japonais) ; Hauteur : 50/100 ; Floraison
: juin/juillet ; Plante locale.
- 5. Penisetum orientalis (Herbe aux écouvillons) ; Hauteur :30/40
; Floraison :juillet à octobre.
- 6. Phragmites communis (Roseaux commun)
- 7. Gunnera brasiliensis syn. G. manicata (Rhubarbe géante)
; Hauteur :180/ 300 ; Floraison : dès avril.
- 8. Buddleia davidii (arbre à papillon) ; Hauteur : 200/
300 ; Floraison : juillet à octobre ; Plante locale ; arbuste intéressant
car il attire les papillons.
- 9. Rhus typhina (sumac, vinaigrier) : Hauteur :300/450 ; Floraison
; juin/juillet ; Plante locale.
- 10. Syringa vulgaris (lilas) ; Hauteur 200/400 ; Floraison :
mai/juin ; Plante locale.
- 11. Ribes sanguineum (groseiller à fleurs) ; Hauteur :
200/300 ; Floraison : printemps.
- 12. Forsythia intermedia (mimosa de Paris) ; Hauteur : 250/300
; Floraison : mars/avril.
- 13. Sambucus racemosa (sureau) ; Hauteur : 200/300 ; Floraison
: printemps ; Plante locale.
- 14. Helianthus decapetalus (Hélianthe à dix pétales) ; Hauteur
: 120/180 ; Floraison : (jaune) septembre.
- 15. Salix pendula (Saule marsault pleureur) ; Hauteur : 600 ;
Floraison : mars/avril.
- 16. Arundo donax (canne de Provence) ; Hauteur : 200/ 500 ; prospère
en Europe du sud, les tiges doivent être coupées en automne
et les souches doivent être recouvertes de tourbe, de feuilles mortes
ou de paille pour protéger les racines pendant l'hiver dans les
régions froides.
- 17. Canna hybrida (Canna, lucifer, balisier) ; Hauteur :120/150 ; Floraison
:fin de l'été ; en hiver la plante sera soit paillée,
soit mise à l'abri.
- 18. Philadelphus lemoinei (seringa) ; Hauteur :150/200 ; Floraison
: juin/juillet ; fleurs à parfum intense.
- 19. Rocaille.
- 20. Passage en dalles de grès prolongeant la rocaille.
- 21. Gros galets.
- 22. Terrasse en caillebotis de bois.
- 23. Cornus alba spaethii (cornouiller) ; Hauteur : 250/ 300 ;
Floraison : printemps (insignifiante) ; écorce rouge en hiver.
- 24. Weigela florida (weigéla fleuri) ; Hauteur :150/200 ; Floraison
: mai/ juin.
- 25. Spartium junceum (genet d'Espagne) ; Hauteur : 250 ; Floraison
: juin/août.
- 26. Miscanthus zebrinus (Eulalie zebrée) ; Hauteur : 90/
120 ; Floraison : automne.
- 27. Sophora japonica pendula (Arbre des Pagodes du Japon pleureur)
; Hauteur :400/500 ; Floraison : septembre.
- 28. Escalier forme de pavés rustiques retenus par des traverses
de chemin de fer.
- X. Souche d'arbre entourée de Hemerocallis (Lis d'un jour)
; Hauteur : 70/80 ; Floraison : juin/août.
J'espère que vous avez maintenant tous les éléments
en main pour faire de votre jardin un petit coin de paradis dont la pièce
maîtresse sera bien sûr le bassin. Pour finir je voudrai vous
rappeler que la faune joue également un rôle important. Les
poissons tels que les carassins ou les carpes Koï sont bien sûr
les éléments les plus connus. Toutefois le fait d'introduire
des tortues aquatiques ou des grenouilles ne nuit pas, bien au contraire.
Les grenouilles peuvent cependant par leur coassements devenir une gêne
durant la saison des amours et vous risquez éventuellement d'avoir
des problèmes avec vos voisins. Si j'ai insisté sur les
abords du bassin, c'est également parce que les arbustes apportent
un refuge aux oiseaux qui viendront égailler vos heures de loisir
et c'est un vrai plaisir que de les voir s'abreuver ou prendre un bain
dans votre bassin. Peut être même que vous aurez la chance
de voir des hirondelles venir chercher des particules de boue pour construire
leur nid et cela seulement à deux ou trois mètres de vous.
NOTE DE L'AUTEUR : Il est préférable d'éviter l'introduction
d'écrevisses dans ce type de bassin. En effet, celles-ci à
l'aide de leurs pinces peuvent déchirer la feuille de polyéthylène
et forer un abri dans la couche d'argile, entraînant consécutivement
des fuites d'eau.
 CONSTRUCTION
D'UN BASSIN DE JARDIN DE 50 000 LITRES
CONSTRUCTION
D'UN BASSIN DE JARDIN DE 50 000 LITRES