 "LES MANGEURS
DE TERRE" ou Géophages
"LES MANGEURS
DE TERRE" ou Géophages
par Robert ALLGAYER - AQUARIUM 32, STRASBOURG. (Revue Aquarama,
1988)
Pour le néophyte, ce groupe de poissons, appartenant à la
famille des Cichlidés, exhibe un mode alimentaire qui, par erreur,
est assimilé au terrassement du fond de l'aquarium. Outre cette
curieuse "filtration" du substrat, des Cichlidés, suivant
les espèces, montrent plusieurs stades d'évolution dans
leur mode de reproduction.
 |
| Ci-dessus: Geophagus
steindachneri chez lequel le front et la bosse sont de couleur
rouge. Ci-dessous: "Geophagus" brasiliensis, une espèce plus proche des "Cichlasoma" par sa morphologie et son comportement. Photos : R. Allgayer |
 |
Les "Géophages" ou mangeurs de terre sont un groupe
de Cichlidés hétérogènes comprenant plusieurs
genres ayant des relations phylogénétiques plus ou moins
éloignées. Il s'agit des espèces des genres Geophagus
(15 espèces), Satanoperca (5 espèces), Gymnogeophagus
(4 espèces), Acarichthys (1 espèce), et dans une
moindre mesure, le genre Biotodoma (2 espèces) et "Aequidens"
geayi. Outre la révision déjà ancienne de Gosse
(1975), Kullander (1986) a réhabilité le genre Satanoperca
en séparant ses espèces actuelles du genre Geophagus.
Il faut y ajouter quelques species qui pour l'instant ne sont pas encore
décrites pour la science mais connues des aquariophiles.
Où les trouver?
Quelques espèces sont maintenant bien implantées en aquariophilie
et les magasins spécialisés offrent couramment Geophagus
steindachneri, G. brasiliensis, G. surinamensis ou Satanoperca
jurupari. Pour les autres espèces il faut souvent se les pêcher
soit même ce qui n'est pas une mince affaire. La répartition
géographique de ce groupe s'étend du Panama (Geophagus
crassilabris) à l'Argentine au Sud (Gymnogeophagus australis),
de Colombie à l'Ouest (Geophagus steindachneri), à
l'extrême Est du Brésil (Geophagus brasiliensis).
Morphologie
Leur taille pourra atteindre une vingtaine de centimètres pour
les espèces les plus grandes (Acarichthys, S. jurupari,
G. brasiliensis) ou plus petite pour Biotodoma et "Aequidens"
geayi. Toutes les espèces n'ont pas le profil céphalique
aigu qui certainement avantage leur mode alimentaire particulier. Gymnogeophagus
balzanii possède un front très bombé, et Geophagus
brasiliensis ressemble plus à un "Cichlasoma"
qu'à un Geophagus. Le corps est en majorité couvert
d'un éclat métallique avec des motifs mélaniques.
Beaucoup d'espèces possèdent une tache noire et ronde au
milieu du corps.
Les mâles se distinguent par de forts prolongements filamenteux
à la nageoire dorsale et anale. Leur taille est souvent aussi plus
conséquente de quelques centimètres. Outre la division à
partir du nombre des épines supraneurales (Gosse, 1975), il est
possible de former des groupes à partir du nombre de branchiospines
sur la partie inférieure de la première branchie.
Nombre moyen de branchiospines (extrèmes):
Acarichthys 6-7
Biotodoma 7 (4-9)
Gymnogeophagus 9 (7-12)
Geophagus 14 (8-17)
Satanoperca 18 (15-22)
Parmi les Geophagus, G. brasiliensis se distingue par un
nombre réduit de ses branchiospines (8-12). Son régime alimentaire
étant macrophage, rejoignant en cela les Cichlasoma sensu
lato, c'est pourquoi certains auteurs placent "Geophagus"
entre parenthèses pour cette espèce.
D'autre part il subsiste une forte corrélation entre un nombre
élevé de branchiospines et un angle neuro-cranien aigu,
ce qui démontre une spécialisation trés élevée
dans le mode alimentaire, notamment pour les espèces du genre Satanoperca.
 |
| En haut: Geophagus surinamensis, forme "française" de Guyane, espèce ovophile. En bas: Geophagus surinamensis forme amazonienne à comportement reproducteur larvophile. Photos : R. Allgayer |
 |
Maintenance et agencement du bac
Ces Cichlidés néotropiques nécessitent un espace
assez vaste en rapport à leur taille adulte. La longueur frontale
devra être de 120 à 150 cm, pour une hauteur d'eau d'au moins
50 cm. Le fond du bac est couvert de sable de Loire pour les filtreurs
spécialisés du substrat, et de gravier plus grossier pour
les autres espèces. La réalisation d'un aquarium typiquement
géographique est parfaitement possible en utilisant des racines
de tourbière, et des plantes plus ou moins fragiles. La cohabitation
avec d'autres Cichlidés de taille similaire ou inférieure
mais aux moeurs différentes est souhaitable. Un exemple d'une cohabitation
et d'une maintenance réussie (photo) pourra se faire avec Satanoperca
jurupari (5 spécimens) 10 Astronotus cuivrés,
5 Aequidens tetramerus et 10 Corydoras dans un bac de 500
litres. Le nombre élevé (relatif) d'Oscars permet de maintenir
un climat "serein" dans le bac entre ces Cichlidés réputés
pour leurs moeurs bourrues. Le manque de possibilité de formation
de territoire inhibe toute velléité agressive réciproque.
Les Jurupari se maintiennent la pluspart du temps près du
substrat, les Oscars en pleine eau, et les Aequidens entre les plantes.
Ces derniers de taille inférieure (8-12 cm) arrivent à se
créer un territoire, mais qui n'a pas de signification à
l'intérieur de l'espèce. L'arrière du bac est couvert
d'un décor en polystyrène isolé de l'eau par une
résine type alimentaire teintée dans la masse en brun-sombre
et saupoudrée de poussière de quartz.
Une telle densité de population impose une filtration énergique.
Celle-ci est assurée par un bac de décantation à
trois compartiments où l'eau est collectée à la surface
pour le compartiment avant, près du fond à travers le décor
(tunnel) pour le compartiment arrière. L'eau traverse dans chacun
des deux compartiments une masse filtrante en polyester sur toute la hauteur
du bac de décantation. Après son passage sur les mousses,
elle est collectée dans le compartiment central pour être
expulsée dans le bac par une turbine (genre: Turbelle, Rotron ou
autres).
Dans l'un des compartiments d'entrée sera placé le diffuseur
d'eau et le chauffage. Cette méthode de filtration exclusivement
mécanique permet d'obtenir une eau limpide. Les Géophagus
(sensu lato) sont des Cichlidés qui soulèvent beaucoup de
particules à partir du substrat. Les changements d'eau ainsi que
les nettoyages des mousses seront fréquents. Un changement d'eau
massif (moitié du bac) et le rincage d'une des mousses par semaine
sont impératifs.
Bien qu'originaire d'Amérique du Sud, la maintenance de ces poissons
peut se faire dans l'eau de conduite, elle ne devra toutefois pas être
trop calcaire. Une eau au pH de 7,0 à 7,8 et d'une dureté
de 15 à 20 THf', à une température de 25-28 °C,
convient pour la maintenance en bac d'agrément. Si l'eau douce,
peu minéralisée, est disponible en grande quantité,
il est évident qu'elle aura la préférence pour la
maintenance de ces espèces.
L'alimentation est la partie de la maintenance la plus aisée chez
ces "Mangeurs de terre". Ce sont des détritivores, sauf
G. brasiliensis, qui consomment toutes les parties comestibles
rencontrées sur ou dans le substrat. Ils répugnent à
monter vers la surface de l'eau pour y chercher la nourriture. Par contre
les paillettes ou toutes autres nourritures flottant un moment à
la surface seront recherchées. Dans le cas d'une association avec
une espèce gloutonne comme les Oscars, il convient d'abord de satisfaire
ceux-ci, par exemple avec des moules entières ou des crevettes,
puis dans un second temps de distribuer ces mêmes nourritures mais
écrasées en particules plus petites, qui pour la plupart
sont ignorées par les Astronotus. Il est important de veiller
à cette concurrence alimentaire dont pourront souffrir les "Mangeurs
de terre" lors d'une cohabitation avec une espèce "vorace".
La cohabitation avec des petits characidés d'une taille inférieure
à 6-8 cm n'est pas souhaitable non plus. Bien que n'étant
pas piscivore, ces espèces pourraient de temps à autre s'offrir
un petit extra bien tentant.
 |
| En haut: Gymnogeophagus
balzanii, a vraiment une gueule de buldozer. En bas: Satanoperca jurupari forme péruvienne à incubation larvophile. |
 |
Reproduction
Ce groupe de poissons ayant un mode alimentaire similaire dans la plupart
des cas, possède diverses formes de reproduction. Ces espèces
possèdent en commun la nécessité de les maintenir
en eau douce et acide pour les amener à se reproduire.
Ces espèces sont monogames, à l'exception de G. steindachneri,
pour ce qui est des espèces observées. Toutes pondent soit
sur un substrat découvert, soit sur un substrat caché. Certaines
espèces sont connues de diverses régions géographiques.
Ainsi Geophagus surinamensis et Satanoperca jurupari sont
connues en Amazonie mais également des hauts plateaux guyanés.
Ces dernières formes étant des incubateurs ovophiles.
D'une façon générale il sera préférable
de maintenir ces espèces dans un bac de 200-300 litres pour la
reproduction. Les pondeurs sur substrat caché, devront trouver
des caches suffisamment vastes. noix de coco ou pot de fleur pour Biotodoma
et "Aequidens" geayi, des tubes en PVC de 100 mm de diamètre
pour Acarichthys heckelii. Les pondeurs sur substrat découvert
qui regroupent également les incubateurs buccaux larvophiles ou
ovophiles - la ponte au sens strict se fait toujours au contact d'un substrat
- devront retrouver quelques pierres plates mais également du sable
fin pas trop clair. Pas seulement parce qu'ils filtrent ce substrat pour
la recherche de nourriture, mais du fait que quelques espèces recouvrent
leurs oeufs de sable pendant un certain temps (24-48 hrs), notamment Satanoperca
daemon, ou Gymnogeophagus gynmogenys. Il ne faut surtout pas
s'affoler dans ce cas si les oeufs ont disparu et que la femelle ou alternativement
le couple ventille un tas de sable. Les oeufs sont bien dessous, ce n'est
qu'une forme de camouflage. D'autres espèces creusent également
des cuvettes dans le sable où sont transférées les
larves pour y résorber leur sac vittelin jusqu'à la nage
libre. C'est le cas des espèces plus "primitives" comme
"Geophagus" brasiliensis ou Gymnogeophagus rhabdotus.
Les incubateurs buccaux larvophiles et ovophiles gardent les larves et
les oeufs, puis les alevins en bouche pendant une durée assez variable.
De 10 à 18 jours, le temps le plus long est celui de Geophagus
steindachneri qui se trouve être un ovophile strict. Les alevins
sont encore protégés pendant 2 à 3
semaines. Lors de la formation du couple, mais également par la
suite, il importe là également de faire cohabiter quelques
poissons ne présentant aucun danger mais qui atteignent une certaine
taille, et suffisamment véloces pour échapper à une
attaque éventuelle des "mangeurs de terre". Les espèces
qui se prêtent comme stimulateurs de garde sont les Characidés
de taille moyenne, comme Hemigrammus caudovittatus ou Hemigrammus
nana.
Les alevins, à partir de leur apparition, devront être nourris
de nauplii d'Artemia. Cependant les femelles, pour les espèces
incubantes, filtrent le substrat et il n'est pas exclu que déjà
les alevins dans la bouche des parents trouvent des particules comestibles.
Les espèces larvophiles sont certainement les plus difficiles à
reproduire. Les larves sont souvent recrachées ou avalées,
par les mouvements intempestifs autour ou dans l'aquarium. Les pondeurs
sur substrat caché, ainsi que ceux sur substrat découvert,
surtout "Geophagus" brasiliensis, ne posent pas trop
de problèmes. Une bonne alimentation, mais surtout des changements
fréquents d'eau neuve, sont les seuls "secrets" de la
réussite et la reproduction de ces "terrassiers" attachants.
 |
| Acarichthys heckelii, un cichlidé somptueux, convoité par beaucoup de cichlidophiles. |
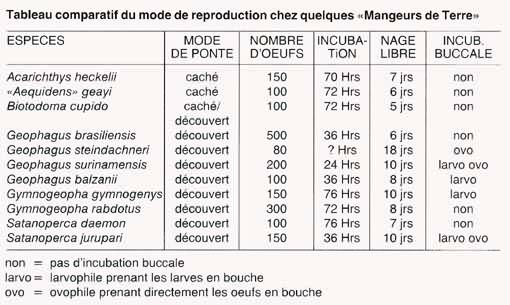 |
Bibliographie
Allgayer. R.; (1982) Un Cichlidé "français" "Aequidens"
geayi Aquarama 65: 14-17 et 66: 22-24.
Allgayer. R.; (1982) Geophagus brasiliensis; Geophagus oui
ou non? Rev. Franc. Cichlid 23: 22-25.
Allgayer. R.; (1983) Son éminence ... Geophagus steindachneri
Aquarama 74: 11-13. Allgayer. M-L & R. Allgayer; (1980) L'incubation
buccale, protection optimum des oeufs, larves et alevins. Aquarama 55:
20-21; 70-72 et Aquarama 56: 20-23; 39; 75.
Gosse. J-P.; (1975) Révision du genre Geophagus. Mém.
Acad. R. Sci. Outremer. Cl. Sci. nat. Méd. (N.S) 19 (3): 1-172.
Kullander. S. O.; Cichlides Fishes of the Amazon River Drainage of Peru.
1986 Swedish Museum, Stockholm: 1-431.
Staeck. W. & H. Lincke; Amerikanische Cichliden II Große Buntbarsche
1985 Tetra Verlag, Melle: 1-164.
Stawikowski. R. & U. Werner; Die Buntbarsche der Neuen Welt Südamerika
1988 Ed. Kernen; Essen: 1-288.
